Le tour de la question
La géothermie pour climatiser et rafraîchir les villes ?
L’Association française des professionnels de la géothermie a comparé l’intérêt des installations géothermiques par rapport aux solutions adoptées massivement dans les villes, en particulier dans le domaine du refroidissement. L’étude met en avant la rentabilité d’un basculement total vers la géothermie, mais aussi ses avantages indirects à long terme, avec à la clé d’importants gains économiques.
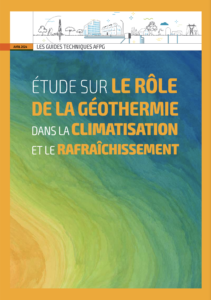
L’Étude sur le rôle de la géothermie dans la climatisation et le rafraîchissement, disponible ici, a été publiée en avril 2024 par l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG). Elle vise à sensibiliser les décideurs, notamment les élus, aux vertus de la géothermie de surface, à relativiser ses coûts d’installation et à tenir compte de ses avantages cachés. En France, les exemples de géothermie profonde sont nombreux, notamment à Paris et en proche banlieue ainsi qu’en Alsace, et de nombreuses villes ont déployé de la géothermie de surface, plus simple à mettre en œuvre et moins coûteuse.
Un raisonnement souvent à petite échelle
Dans la plupart des cas, les installations ne couvrent qu’une petite partie des besoins et elles sont essentiellement utilisées pour le chauffage. Le rafraîchissement des bâtiments, lui, se fait généralement via des climatiseurs électriques installés en toiture et qui rejettent la chaleur à l’extérieur. « La géothermie de surface alimente rarement des réseaux de chaleur et de froid. Ce sont souvent de petites opérations, car on raisonne davantage à l’échelle d’un bâtiment », indique Xavier Moch, ingénieur expert en géothermie de surface à l’AFPG.
Dans ce contexte, l’association souhaitait savoir ce qu’il se passerait si la géothermie était déployée sur tous les bâtiments d’une ville ayant besoin d’être rafraîchis, en recourant au géocooling, donc sans faire appel aux compresseurs des pompes à chaleur. « Dans le cadre de l’étude, les bâtiments ont été répartis en plusieurs catégories (maisons individuelles, résidentiel collectif, hôpitaux, etc.) et des profils types ont été définis pour chacune d’entre elles, explique Xavier Moch. Nous avons également considéré une solution de référence. Cette dernière intègre un système de chauffage au gaz et une climatisation classique. »
Atténuer l’effet d’îlot de chaleur
En prenant l’exemple de Paris, l’étude a d’abord évalué l’impact économique de solutions géothermiques déployées individuellement au niveau de tous les bâtiments. Pour cela, l’AFPG a analysé les différents coûts d’investissement et les coûts opérationnels annuels. « Si l’investissement est plus élevé pour la géothermie que pour les autres solutions, les coûts opérationnels, eux, sont beaucoup plus faibles. La géothermie présente un réel intérêt économique et elle est rentable à long terme, mais à condition de satisfaire le chauffage, et pas seulement le rafraîchissement », affirme Xavier Moch. À Paris, le coût total pour chauffer et rafraîchir toute la ville par géothermie est ainsi estimé à près de 7 milliards d’euros sur 25 ans. Les économies sur la facture énergétique s’élèveraient quant à elles à plus de 220 millions d’euros par an (et près de 200 millions d’euros pour le chauffage).
En outre, l’étude s’est penchée sur les avantages indirects de la géothermie, rarement analysés. Par exemple, celle-ci offrirait plus de stabilité au réseau électrique, en évitant les pointes de consommation dues aux climatiseurs, et elle éviterait des travaux de renforcement des lignes. Plus intéressant dans les grandes villes, la géothermie aurait également un impact sur les îlots de chaleur. « Les climatiseurs classiques contribuent à la formation d’îlots de chaleur, alors que la géothermie permet de les réduire [la chaleur collectée étant renvoyée dans le sous-sol, ndlr], d’autant plus que les bâtiments semblent alors agir comme des émetteurs de froid. »
En rafraîchissant une ville entière via la géothermie, les effets liés aux périodes de forte chaleur seraient donc sensiblement réduits, en particulier la perte de productivité au travail, le nombre d’hospitalisations et le taux de mortalité. « Dans une ville comme Paris, la somme des gains économiques pourrait ainsi atteindre près d’un milliard d’euros sur 50 ans », assure Xavier Moch.



